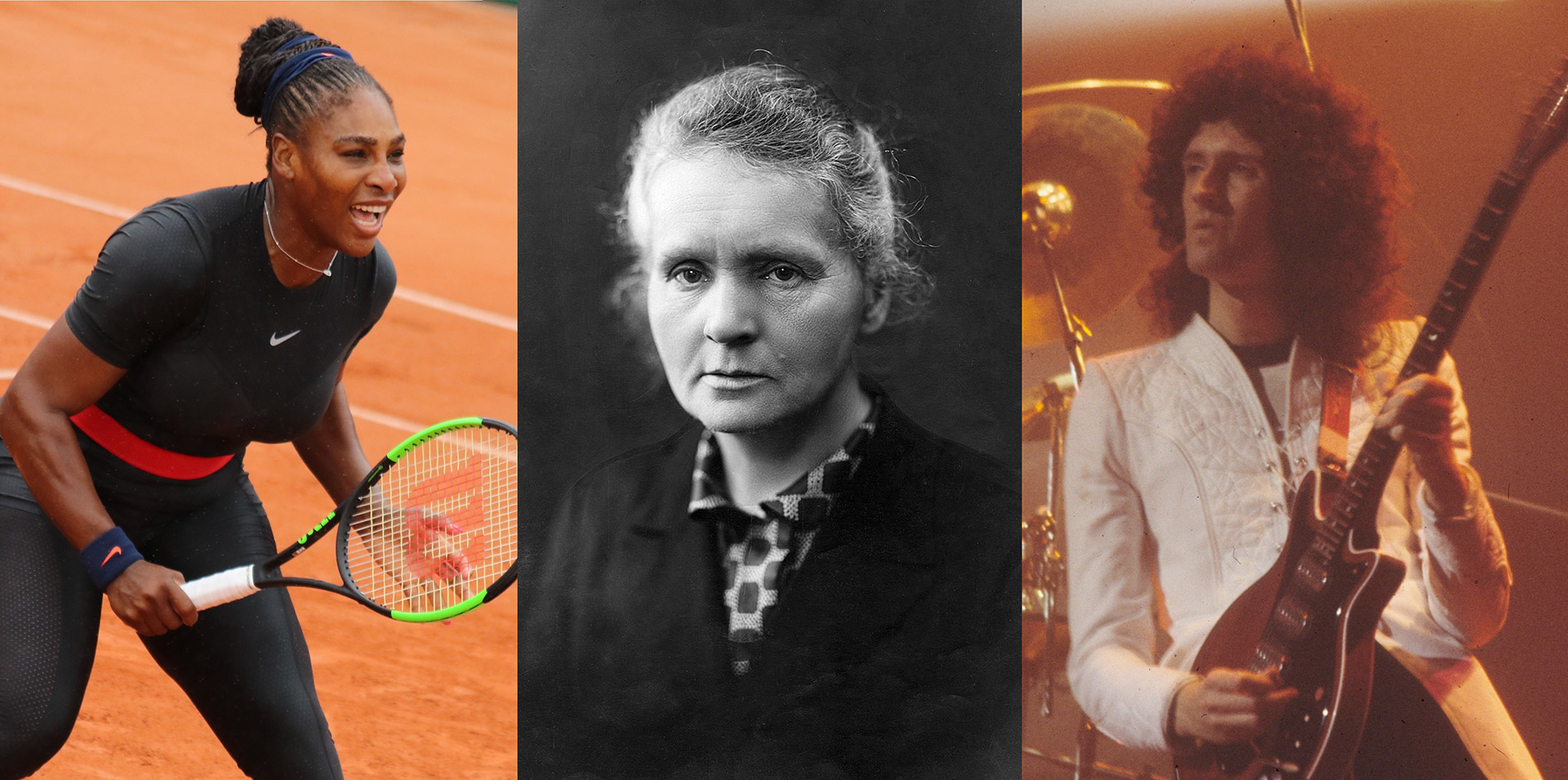Le mois dernier, nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter Twitter en raison de la toxicité ambiante et des dérives de son « reich » propriétaire Elon Musk. Mais la réflexion sur l’usage des réseaux sociaux ne s’arrête pas là : Facebook suscite un débat similaire. Entre dépendance numérique et nécessité stratégique, faut-il aussi tourner le dos à cette plateforme ?
Comme le souligne Jonathan Durand Folco, coauteur du livre « Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle », les raisons de quitter Facebook ne manquent pas. Les restrictions imposées aux médias traditionnels, la publicité ciblée, la collecte massive de données, la censure des contenus propalestiniens et l’algorithme favorisant la polarisation en font une plateforme problématique.
Pire encore, depuis le début de l’année, le nouvel oligarque Zuckerberg est en mode séduction auprès de Trump. Cela se manifeste par des changements majeurs dans la modération de contenu, incluant la suppression de la vérification professionnelle des faits et l’assouplissement des restrictions sur les discours haineux. Ces décisions suscitent des préoccupations légitimes concernant la désinformation et les risques en ligne. Malgré ces problèmes, plusieurs restent sur Facebook par contrainte autant que par choix. La contrainte tient au fait que ce réseau a, au fil des années, capté et verrouillé une large partie des échanges sociaux et politiques en ligne. Quitter Facebook signifie souvent perdre un auditoire, des liens professionnels, voire une visibilité essentielle pour ceux qui y diffusent des idées ou du contenu. Les alternatives existent, comme Bluesky, Friendica ou Mastodon, mais elles peinent encore à offrir la même portée et sont tributaires d’une adoption collective qui tarde à se concrétiser.
Le choix de rester repose sur une autre logique : celle de l’engagement en terrain hostile. Facebook, malgré ses défauts, demeure un espace public numérique de premier plan. Il offre une tribune pour atteindre des publics diversifiés, y compris ceux qui ne chercheraient pas spontanément un contenu politique ou critique ailleurs. Dans cette perspective, certains estiment qu’abandonner cet espace reviendrait à laisser la place à d’autres discours, parfois réactionnaires, sans y opposer de contrenarratif. Une telle décision serait donc une concession stratégique plutôt qu’un acte de résistance.
Toutefois, cette position a ses limites : occuper l’espace médiatique sur Facebook ne garantit pas une réelle influence. Comme le souligne Durand Folco, la gauche peine à élargir son audience. Il ne suffit pas d’écrire des textes engagés ; il faut aussi exploiter des formats plus accessibles comme la vidéo ou le podcast. Une approche multiplateforme, combinant Facebook, médias traditionnels et alternatives numériques, semble donc plus pertinente.
Reste la question de la résilience face à l’adversité numérique. Les plateformes sociales étant de plus en plus hostiles, il devient crucial de ne pas dépendre d’un unique canal de communication. Construire des réseaux alternatifs, investir des espaces indépendants et favoriser une approche collective de la communication semblent des stratégies incontournables.
Finalement, faut-il quitter Facebook ? La réponse dépend de l’équilibre entre la nécessité de préserver sa santé mentale et celle de mener une bataille culturelle et politique là où elle se joue encore. Mais une chose est certaine : la dépendance à un réseau centralisé et controversé est un risque, et diversifier les espaces d’échange et de mobilisation est un impératif à long terme.