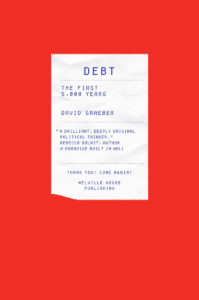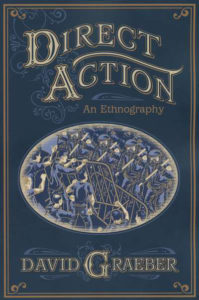David Graeber est devenu aujourd’hui un penseur incontournable de la gauche radicale. L’anthropologue américain offre, dans ses nombreux ouvrages, des analyses originales de la finance, des témoignages inédits d’un activiste professionnel et de puissants plaidoyers en faveur de la démocratie… la vraie démocratie.
Au lendemain de la crise financière de 2008, le lecteur féru de littérature économique était confronté à une véritable avalanche d’ouvrages sur les causes de ladite crise. Plusieurs économistes de renom, des prix Nobel, ont tenté de fournir leur explication de la plus importante crise depuis celle de 1929. Sauf exception, tous ressassaient les mêmes histoires connues sur la création excessive de prêts immobiliers risqués, leur revente par Wall Street et la création subséquente de produits financiers si complexes que les régulateurs n’y comprenaient à peu près rien. Parmi ces rayons de briques bien pensantes, publiées dans l’urgence de l’événement, le livre de Davis Graeber, Debt, the first 5000 years, pouvait aisément passer inaperçu. Et pourtant.
Si les accusations contre Wall Street étaient de bon ton au lendemain du krach, ce n’est pas à un exercice d’accusation et de pointage de doigt que Graeber se livrait dans Debt. Graeber, qui est un des leaders de ce mouvement sans leader qu’est Occupy Wall Street, s’est plutôt attaqué aux racines du problème. Debt est un livre qui médite longuement sur l’origine de la monnaie afin de contester, d’une manière magistrale, l’idée communément admise, depuis Adam Smith, que la monnaie est une création privée. En effet, dans la «mythologie» libérale, la monnaie est une façon qui permettait, avance-t-on, de rendre plus efficaces les échanges marchands. La monnaie aurait, selon cette fiction, remplacé le troc.
Ce que nous dit Graeber, à l’aide de nombreux exemples, c’est que la monnaie n’a toujours en fait été que la manifestation tangible d’une dette. Ce ne serait en fait qu’une mesure originelle de dettes diverses et ces dettes ne sont pas seulement contractées dans un contexte commercial. Une des premières formes de dette fut bien sûr celle contractée dans un mariage, faisant du même coup, nous fait remarquer Graeber, de la femme une des premières «monnaies» d’échange. Ainsi, nous explique l’anthropologue, un chef de clan pourra tirer son pouvoir de sa descendance féminine nombreuse.
À l’époque moderne, la monnaie métallique représente toujours une dette. En Angleterre, où l’une des premières banques centrales «privées» a vu le jour, la monnaie n’était au final que la représentation matérielle d’une dette de l’État envers la banque. Évidemment, cela ne signifie pas que l’État soit d’une quelconque façon l’esclave des banques, bien au contraire. L’État avait aussi un autre moyen pour favoriser la circulation d’une monnaie d’échange dont elle seule, au final, pouvait fixer la valeur. En payant ses soldats à l’aide de monnaie métallique (de cuivre par exemple) et en acceptant cette monnaie pour le paiement des impôts, l’État avait le pouvoir de créer de toutes pièces un marché dont il profitait allègrement. Ainsi, de nos jours, quand une institution financière crée de la monnaie (de la dette), elle ne le fait que parce qu’elle obtient le droit de l’État de le faire…
C’est là le point principal de l’ouvrage de Graeber : la séparation entre l’État et les marchés est une fiction. Et le cri libéral contre l’intrusion de l’État dans les marchés, une parodie.
La démocratie, une chimère?
Graber a aussi publié en 2009, Direct Action : An Etnography, où il relate, avec moult détails, les rencontres et les actions du mouvement antimondialisation qui a culminé à Québec au fameux sommet des Amériques en 2001. Il souhaite ainsi combler le vide de documentation sur le fonctionnement de ces groupes. C’est une lecture qui devrait être obligatoire pour n’importe quel contestataire en devenir.
Plus récemment, en 2013, Graeber publiait The Democracy Project, dans lequel il relate les débuts du mouvement Occupy. Celui-ci n’était, nous rappelle Graeber, que l’extension nord-américaine (puis européenne) d’un mouvement de révolte plus large initié durant le printemps arabe, notamment en Égypte. Le mouvement des 99% est une idée de Graeber, inspirée d’un article de Joseph Stiglitz sur les tout-puissants 1%.
Dans cet ouvrage fort éclairant, Graeber traite autant du fonctionnement anarchiste du groupe que du traitement du groupe dans les médias (relativement positif). Il explique pourquoi le regroupement a refusé de faire ce que plusieurs leur ont demandé de faire, c’est à dire de fournir des demandes ou de s’«engager dans le système politique en place». Il explique que l’exemple de l’élection d’Obama a permis à plusieurs militants de constater que la voie des urnes ne pouvait produire de véritables résultats. «Considérant l’état de crise dans lequel l’économie américaine se trouvait quand Obama a été élu en 2008, cela requérait des efforts perversement héroïques pour répondre à une catastrophe historique en gardant tout plus ou moins intact», déplore Graeber. Si les Américains souhaitent réellement du changement, ce changement devra être obtenu, selon Graeber, «par d’autres moyens».
Au sujet de la démocratie, Graeber rappelle que celle-ci n’est pas nécessairement définie par le vote de la majorité. «C’est plutôt un processus de délibération collective basé sur le principe de la complète et égale participation», rappelle-t-il. Pour Graeber, la démocratie, c’est essentiellement un «procédé de résolution collective de problème». Les êtres humains partagent un grand nombre de «problèmes communs» et, encore aujourd’hui, la plupart s’entendent pour dire que la délibération collective est une manière optimale d’en venir à des solutions. «On est 6 millions, faut s’parler», disait la pub. Pourquoi alors, demande Graeber, l’idée que nous tentions vraiment de mettre en œuvre un tel processus est-elle décriée comme une chimère?